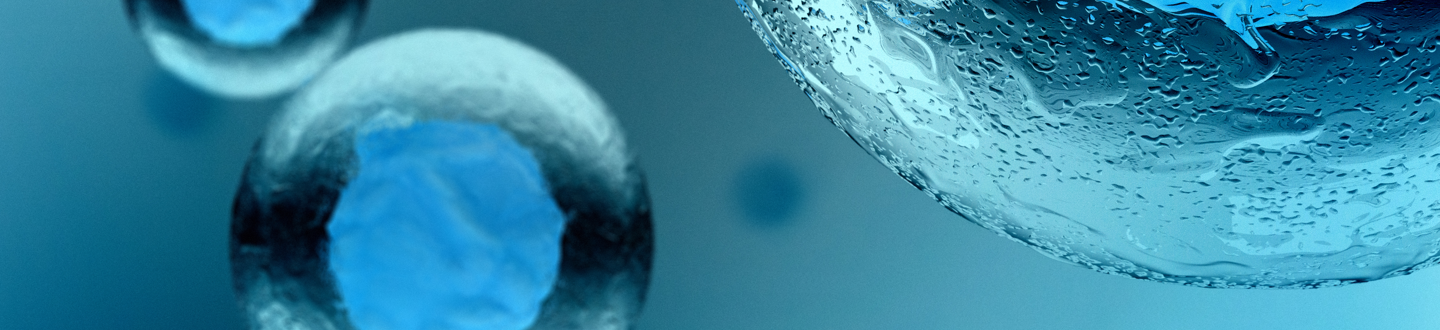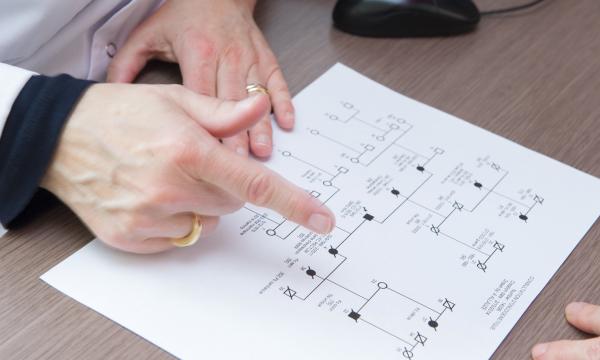Comment savoir que l’on est atteint du syndrome de Lynch ?
Ce syndrome est évoqué quand plusieurs membres d’une même famille ont développé un cancer colorectal ou pour les femmes un cancer de l’endomètre (corps de l’utérus) et/ou lorsque ce diagnostic s’est fait à un âge inhabituellement jeune.
La recherche au niveau de la tumeur d’une instabilité micro satellitaire (appelée : statut MSI) témoin du disfonctionnement des gènes MMR (intervenant dans la réparation des mésappariements de l’ADN ) vient conforter cette hypothèse. Ce syndrome sera confirmé par analyse génétique : identification d’une mutation délétère sur un des 4 gènes MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2).
Quels sont les risques pour les personnes atteintes du syndrome de Lynch ?
Le risque principal concerne le cancer colorectal touchant aussi bien les hommes que les femmes. Le second concerne uniquement les femmes : il s’agit du cancer de l’endomètre, et plus rarement le cancer de l’ovaire.
Ces cancers surviennent généralement prématurément, avant l’âge de survenue habituel dans la population générale. On retrouve également un risque accru d’autres cancers notamment, de l’estomac, l’intestin grêle, les voies biliaires, les voies urinaires … Ces risques restent toutefois beaucoup plus faible.
Quels sont les conseils de dépistage à suivre ?
- Sur le plan digestif :
Coloscopie avec coloration à l’indigo carmin à partir de l’âge de 20/25 ans tous les 2 ans. Pour être performant, cet examen nécessite une préparation soigneuse. Il permet de reséquer préventivement des polypes avant qu’ils ne deviennent des cancers. En cas de mauvaise préparation il faut refaire l’examen à 1 an. Il n’y a pas d’indication de chirurgie prophylactique à ce niveau d’où l’importance de cette surveillance. Il est recommandé d’associer au premier examen une gastroscopie avec recherche de la bactérie : Helicobacter pylori qui augmente également le risque de cancer gastrique et qui doit dans ce contexte faire l’objet d’un traitement spécifique.
- Sur le plan gynécologique :
Il est recommandé un examen clinique avec échographie endovaginale à partir de l’âge de 30 ans tous les 1 an et si possible une biopsie de l’endomètre tous les 2 ans. Le bénéfice de ce dépistage n’est toutefois pas complètement démontré ce qui peut conduire à discuter une ablation préventive de l’utérus et des ovaires aux femmes qui le souhaitent généralement après 40/45 ans.
- Concernant les autres tumeurs :
Leur risque étant faible et le bénéfice d’un dépistage non prouvé, il n’y a pas de recommandation consensuelle sauf s’il existe une histoire familiale particulière. Malgré ce suivi, tout symptôme anormal doit amener à une consultation médicale malgré ce suivi. Depuis peu, cette surveillance peut se faire dans le cadre d’un programme régional (GENERA pour la région Rhône-Alpes) de suivi personnalisé des patients à très haut risque génétique. Il a pour but de coordonner le suivi des patients, d’en améliorer la compliance en fournissant un plan personnalisé validé en concertation pluridisciplinaire, d’envoyer des relances avant chaque examen et de récupérer les CR pour adapter la prise en charge si nécessaire.